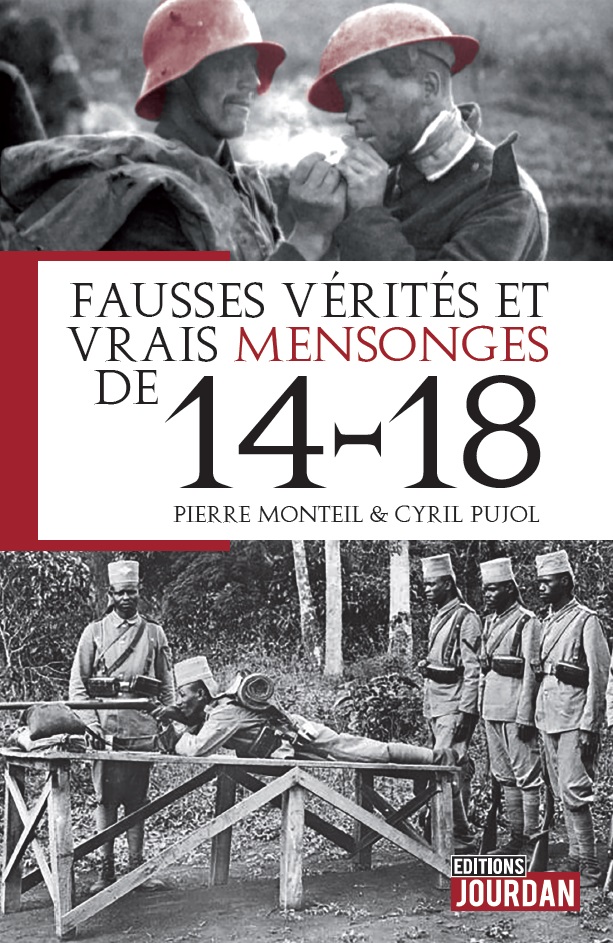Lorsque Alexandre eut détruit l’empire des Perses, il voulut que l’on crût qu’il était fils de Jupiter. Les Macédoniens étaient indignés de voir ce prince rougir d’avoir Philippe pour père : leur mécontentement s’accrut lorsqu’ils lui virent prendre les moeurs, les habits et les manières des Perses ; et ils se reprochaient tous d’avoir tant fait pour un homme qui commençait à les mépriser. Mais on murmurait dans l’armée, et on ne parlait pas.
Un philosophe nommé Callisthène avait suivi le roi dans son expédition. Un jour qu’il le salua à la manière des Grecs : D’où vient, lui dit Alexandre, que tu ne m’adores pas ? « Seigneur, lui dit Callisthène, vous êtes chef de deux nations : l’une, esclave avant que vous l’eussiez soumise, ne l’est pas moins depuis que vous l’avez vaincue ; l’autre, libre avant qu’elle vous servit à remporter tant de victoires, l’est encore depuis que vous les avez remportées. Je suis Grec, seigneur ; et ce nom, vous l’avez élevé si haut que, sans vous faire tort, il ne nous est plus permis de l’avilir. »
Les vices d’Alexandre étaient extrêmes comme ses vertus : il était terrible dans sa colère ; elle le rendait cruel. Il fit couper les pieds, le nez et les oreilles à Callisthène, ordonna qu’on le mît dans une cage de fer, et le fit porter ainsi à la suite de l’armée.
J’aimais Callisthène ; et de tout temps, lorsque mes occupations me laissaient quelques heures de loisir, je les avais employées à l’écouter : et, si j’ai de l’amour pour la vertu, je le dois aux impressions que ses discours faisaient sur moi. J’allai le voir. « Je vous salue, lui dis-je, illustre malheureux, que je vois dans une cage de fer comme on enferme une bête sauvage, pour avoir été le seul homme de l’armée. »
« Lysimaque, me dit-il, quand je suis dans une situation qui demande de la force et du courage, il me semble que je me trouve presque à ma place. En vérité, si les dieux ne m’avaient mis sur la terre que pour y mener une vie voluptueuse, je croirais qu’ils m’auraient donné en vain une âme grande et immortelle. Jouir des plaisirs des sens est une chose dont tous les hommes sont aisément capables ; et si les dieux ne nous ont faits que pour cela, ils ont fait un ouvrage plus parfait qu’ils n’ont voulu, et ils ont plus exécuté qu’entrepris. Ce n’est pas, ajouta-t-il, que je sois insensible : vous ne me faites que trop voir que je ne le suis pas. Quand vous êtes venu à moi, j’ai trouvé d’abord quelque plaisir à vous voir faire une action de courage. Mais, au nom des dieux, que ce soit pour la dernière fois. Laissez-moi soutenir mes malheurs, et n’ayez point la cruauté d’y joindre encore les vôtres. »
« Callisthène, lui dis-je, je vous verrai tous les jours. Si le roi vous voyait abandonné des gens vertueux, il n’aurait plus de remords ; il commencerait à croire que vous êtes coupable. Ah ! j’espère qu’il ne jouira pas du plaisir de voir que ses châtiments me feront abandonner un ami. »
Un jour Callisthène me dit : « Les dieux immortels m’ont consolé ; et, depuis ce temps, je sens en moi quelque chose de divin, qui m’a ôté le sentiment de mes peines. J’ai vu en songe le grand Jupiter. Vous étiez auprès de lui ; vous aviez un sceptre à la main, et un bandeau royal sur le front. Il vous a montré à moi, et m’a dit : Il te rendra plus heureux. L’émotion où j’étais m’a réveillé. Je me suis trouvé les mains élevées au ciel, et faisant des efforts pour dire : Grand Jupiter, si Lysimaque doit régner, fais qu’il règne avec justice. Lysimaque, vous règnerez : croyez un homme qui doit être agréable aux dieux, puisqu’il souffre pour la vertu. »
Cependant Alexandre ayant appris que je respectais la misère de Callisthène, que j’allais le voir, et que j’osais le plaindre, il entra dans une nouvelle fureur. Va, dit-il, combattre contre les lions, malheureux qui te plais tant à vivre avec les bêtes féroces. » On différa mon supplice, pour le faire servir de spectacle à plus de gens.
Le jour qui le précéda j’écrivis ces mots à Callisthène : « Je vais mourir. Toutes les idées que vous m’aviez données de ma future grandeur se sont évanouies de mon esprit. J’aurais souhaité d’adoucir les maux d’un homme tel que vous. »
Prexape, à qui je m’étais confié, m’apporta cette réponse : « Lysimaque, si les dieux ont résolu que vous régniez, Alexandre ne peut pas vous ôter la vie ; car les hommes ne résistent pas à la volonté des dieux. »
Cette lettre m’encouragea ; et, faisant réflexion que les hommes les plus heureux et les plus malheureux sont également environnés de la main divine, je résolus de me conduire, non pas par mes espérances, mais par mon courage, et de défendre jusqu’à la fin une vie sur laquelle il y avait de si grandes promesses.
On me mena dans la carrière. Il y avait autour de moi un peuple immense qui venait être témoin de mon courage ou de ma frayeur. On me lâcha un lion. J’avais plié mon manteau autour de mon bras : je lui présentai ce bras, il voulut le dévorer ; je lui saisis la langue, la lui arrachai, et la jetai à mes pieds.
Alexandre aimait naturellement les actions courageuses : il admira ma résolution, et ce moment fut celui du retour de sa grande âme.
Il me fit appeler ; et, me tendant la main : « Lysimaque, me dit-il, je te rends mon amitié, rends-moi la tienne. Ma colère n’a servi qu’à te faire faire une action qui manque à la vie d’Alexandre. »
Je reçus les grâces du roi ; j’adorai les décrets des dieux, et j’attendais leurs promesses sans les rechercher ni les fuir. Alexandre mourut, et toutes les nations furent sans maître. Les fils du roi étaient dans l’enfance ; son frère Aridée n’en était jamais sorti ; Olympias n’avait que la hardiesse des âmes faibles, et tout ce qui était cruauté était pour elle du courage ; Roxane, Eurydice, Statyre, étaient perdues dans la douleur. Tout le monde, dans le palais, savait gémir, et personne ne savait régner. Les capitaines d’Alexandre levèrent donc les yeux sur son trône ; mais l’ambition de chacun fut contenue par l’ambition de tous.
Nous partageâmes l’empire ; et chacun de nous crut avoir partagé le prix de ses fatigues.
Le sort me fit roi d’Asie ; et à présent que je puis tout, j’ai plus besoin que jamais des leçons de Callisthène. Sa joie m’annonce que j’ai fait quelque bonne action, et ses soupirs me disent que j’ai quelque mal à réparer. Je le trouve entre mon peuple et moi.
Je suis le roi d’un peuple qui m’aime. Les pères de famille espèrent la longueur de ma vie comme celle de leurs enfants ; les enfants craignent de me perdre comme ils craignent de perdre leur père. Mes sujets sont heureux et je le suis.