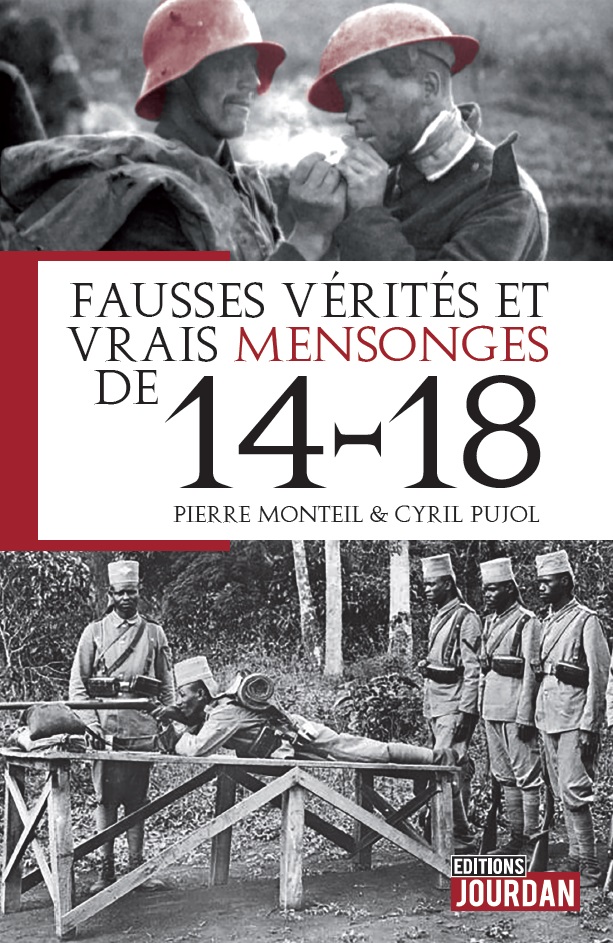Ce ne fut ni la crainte ni la piété qui établit la religion chez les Romains, mais la nécessité où sont toutes les sociétés d’en avoir une. Les premiers rois ne furent pas moins attentifs à régler le culte et les cérémonies qu’à donner des lois et bâtir des murailles.
Je trouve cette différence entre les législateurs romains et ceux des autres peuples, que les premiers firent la religion pour l’état, et les autres, l’état pour la religion. Romulus, Tatius et Numa asservirent les dieux à la politique : le culte et les cérémonies qu’ils instituèrent furent trouvés si sages que, lorsque les rois furent chassés, le joug de la religion fut le seul dont ce peuple, dans sa fureur pour la liberté, n’osa s’affranchir.
Quand les législateurs romains établirent la religion, ils ne pensèrent point à la réformation des moeurs, ni à donner des principes de morale ; ils ne voulurent point gêner des gens qu’ils ne connaissaient pas encore. Ils n’eurent donc d’abord qu’une vue générale, qui était d’inspirer à un peuple, qui ne craignait rien, la crainte des dieux, et de se servir de cette crainte pour le conduire à leur fantaisie.
Les successeurs de Numa n’osèrent point faire ce que ce prince n’avait point fait : le peuple, qui avait beaucoup perdu de sa férocité et de sa rudesse, était devenu capable d’une plus grande discipline. Il eût été facile d’ajouter aux cérémonies de la religion des principes et des règles de morale dont elle manquait ; mais les législateurs des Romains étaient trop clairvoyants pour ne point connaître combien une pareille réformation eût été dangereuse : c’eût été convenir que la religion était défectueuse ; c’était lui donner des âges, et affaiblir son autorité en voulant l’établir. La sagesse des Romains leur fit prendre un meilleur parti en établissant de nouvelles lois. Les institutions humaines peuvent bien changer, mais les divines doivent être immuables comme les dieux mêmes.
Ainsi, le sénat de Rome, ayant chargé le préteur Pétilius d’examiner les écrits du roi Numa, qui avaient été trouvés dans un coffre de pierre, quatre cents ans après la mort de ce roi, résolut de les faire brûler, sur le rapport que lui fit ce préteur que les cérémonies qui étaient ordonnées dans ces écrits différaient beaucoup de celles qui se pratiquaient alors : ce qui pouvait jeter des scrupules dans l’esprit des simples, et leur faire voir que le culte prescrit n’était pas le même que celui qui avait été institué par les premiers législateurs, et inspiré par la nymphe Égérie.
On portait la prudence plus loin : on ne pouvait lire les livres sibyllins sans la permission du sénat, qui ne la donnait même que dans les grandes occasions, et lorsqu’il s’agissait de consoler les peuples. Toutes les interprétations étaient défendues ; ces livres mêmes étaient toujours renfermés ; et, par une précaution si sage, on ôtait les armes des mains des fanatiques et des séditieux.
Les devins ne pouvaient rien prononcer sur les affaires publiques sans la permission des magistrats ; leur art était absolument subordonné à la volonté du sénat ; et cela avait été ainsi ordonné par les livres des pontifes, dont Cicéron nous a conservé quelques fragments.
Polybe met la superstition au rang des avantages que le peuple romain avait par‑dessus les autres peuples : ce qui paraît ridicule aux sages est nécessaire pour les sots ; et ce peuple, qui se met si facilement en colère, a besoin d’être arrêté par une puissance invisible.
Les augures et les aruspices étaient proprement les grotesques du paganisme ; mais on ne les trouvera point ridicules, si on fait réflexion que, dans une religion toute populaire comme celle-là, rien ne paraissait extravagant ; la crédulité du peuple réparait tout chez les Romains : plus une chose était contraire à la raison humaine, plus elle leur paraissait divine. Une vérité simple ne les aurait pas vivement touchés : il leur fallait des sujets d’admiration, il leur fallait des signes de la divinité ; et ils ne les trouvaient que dans le merveilleux et le ridicule.
C’était à la vérité une chose très extravagante de faire dépendre le salut de la république de l’appétit sacré d’un poulet, et de la disposition des entrailles des victimes ; mais ceux qui introduisirent ces cérémonies en connaissaient bien le fort et le faible, et ce ne fut que par de bonnes raisons qu’ils péchèrent contre la raison même. Si ce culte avait été plus raisonnable, les gens d’esprit en auraient été la dupe aussi bien que le peuple, et par-là on aurait perdu tout l’avantage qu’on en pouvait attendre ; il fallait donc des cérémonies qui pussent entretenir la superstition des uns, et entrer dans la politique des autres : c’est ce qui se trouvait dans les divinations. On y mettait les arrêts du ciel dans la bouche des principaux sénateurs, gens éclairés, et qui connaissaient également le ridicule et l’utilité des divinations.
Cicéron dit que Fabius, étant augure, tenait pour règle que ce qui était avantageux à la république se faisait toujours sous de bons auspices. Il pense comme Marcellus, que, quoique la crédulité populaire eût établi au commencement les augures, on en avait retenu l’usage pour l’utilité de la république ; et il met cette différence entre les Romains et les étrangers, que ceux-ci s’en servaient indifféremment dans toutes les occasions, et ceux-là seulement dans les affaires qui regardaient l’intérêt public. Cicéron nous apprend que la foudre tombée du côté gauche était d’un bon augure, excepté dans les assemblées du peuple, præterquam ad comitia. Les règles de l’art cessaient dans cette occasion : les magistrats y jugeaient à leur fantaisie de la bonté des auspices, et ces auspices étaient une bride avec laquelle ils menaient le peuple. Cicéron ajoute : Hoc institutum reipublicæ causa est, ut comitiorum, vel in jure legum, vel in judiciis populi, vel in creandis magistratibus, principes civitatis essent interpretes. Il avait dit auparavant qu’on lisait dans les livres sacrés : Jove tonante et fulgurante, comitia populi habere nefas esse. Cela avait été introduit, dit-il, pour fournir aux magistrats un prétexte de rompre les assemblées du peuple. Au reste, il était indifférent que la victime qu’on immolait se trouvât de bon ou de mauvais augure ; car lorsqu’on n’était pas content de la première, on en immolait une seconde, une troisième, une quatrième, qu’on appelait hostiae succedaneæ. Paul Émile voulant sacrifier fut obligé d’immoler vingt victimes : les dieux ne furent apaisés qu’à la dernière, dans laquelle on trouva des signes qui promettaient la victoire. C’est pour cela qu’on avait coutume de dire que, dans les sacrifices, les dernières victimes valaient toujours mieux que les premières. César ne fut pas si patient que Paul Émile : ayant égorgé plusieurs victimes , dit Suétone, sans en trouver de favorables, il quitta les autels avec mépris, et entra dans le sénat.
Comme les magistrats se trouvaient maîtres des présages, ils avaient un moyen sûr pour détourner le peuple d’une guerre qui aurait été funeste, ou pour lui en faire entreprendre une qui aurait pu être utile. Les devins, qui suivaient toujours les armées, et qui étaient plutôt les interprètes du général que des dieux, inspiraient de la confiance aux soldats. Si par hasard quelque mauvais présage avait épouvanté l’armée, un habile général en convertissait le sens et se le rendait favorable ; ainsi Scipion, qui tomba en sautant de son vaisseau sur le rivage d’Afrique, prit de la terre dans ses mains : « Je te tiens, dit-il, ô terre d’Afrique ! » Et par ces mots il rendit heureux un présage qui avait paru si funeste.
Les Siciliens s’étant embarqués pour faire quelque expédition en Afrique, furent si épouvantés d’une éclipse de soleil, qu’ils étaient sur le point d’abandonner leur entreprise ; mais Ie général leur représenta « qu’à la vérité cette éclipse eût été de mauvais augure si elle eût paru avant leur embarquement, mais que, puisqu’elle n’avait paru qu’après, elle ne pouvait menacer que les Africains. » Par-là il fit cesser leur frayeur, et trouva, dans un sujet de crainte, le moyen d’augmenter leur courage.
César fut averti plusieurs fois par les devins de ne point passer en Afrique avant l’hiver. Il ne les écouta pas, et prévint par là ses ennemis, qui, sans cette diligence, auraient eu le temps de réunir leurs forces.
Crassus, pendant un sacrifice, ayant laissé tomber son couteau des mains, on en prit un mauvais augure ; mais il rassura le peuple en lui disant : « Bon courage ! au moins mon épée ne m’est jamais tombée des mains. »
Lucullus étant près de donner bataille à Tigrane, on vint lui dire que c’était un jour malheureux :« Tant mieux, dit-il, nous le rendrons heureux par notre victoire. »
Tarquin le Superbe, voulant établir des jeux en l’honneur de la déesse Mania, consulta l’oracle d’Apollon, qui répondit obscurément, et dit qu’il fallait sacrifier têtes pour têtes, capitibus pro capitibus, supplicandum. Ce prince, plus cruel encore que superstitieux, fit immoler des enfants ; mais Junius Brutus changea ce sacrifice horrible : car il le fit faire avec des têtes d’ail et de pavot, et par-là remplit ou éluda l’oracle.
On coupait le noeud gordien quand on ne pouvait pas le délier ; ainsi Claudius Pulcher, voulant donner un combat naval, fit jeter les poulets sacrés à la mer, afin de les faire boire, disait-il, puisqu’ils ne voulaient pas manger.
Il est vrai qu’on punissait quelquefois un général de n’avoir pas suivi les présages ; et cela même était un nouvel effet de la politique des Romains. On voulait faire voir au peuple que les mauvais succès, les villes prises, les batailles perdues, n’étaient point l’effet d’une mauvaise constitution de l’état, ou de la faiblesse de la république , mais de l’impiété d’un citoyen, contre lequel les dieux étaient irrités. Avec cette persuasion, il n’était pas difficile de rendre la confiance au peuple ; il ne fallait pour cela que quelques cérémonies et quelques sacrifices. Ainsi, lorsque la ville était menacée ou affligée de quelque malheur, on ne manquait pas d’en chercher la cause, qui était toujours la colère de quelque dieu dont on avait négligé le culte : il suffisait, pour s’en garantir, de faire des sacrifices et des processions, de purifier la ville avec des torches, du soufre et de l’eau salée. On faisait faire à la victime le tour des remparts avant de l’égorger, ce qui s’appelait sacri ficium amburbium, et amburbiale. On allait même quelquefois jusqu’à purifier les armées et les flottes, après quoi chacun reprenait courage.
Scévola, grand pontife, et Varron, un de leurs grands théologiens, disaient qu’il était nécessaire que le peuple ignorât beaucoup de choses vraies, et en crût beaucoup de fausses ; saint Augustin dit que Varron avait découvert par-là tout le secret des politiques et des ministres d’état.
Le même Scévola , au rapport de saint Augustin, divisait les dieux en trois classes : ceux qui avaient été établis par les poètes, ceux qui avaient été établis par les philosophes, et ceux qui avaient été établis par les magistrats, a principibus civitatis.
Ceux qui lisent l’histoire romaine, et qui sont un peu clairvoyants, trouvent à chaque pas des traits de la politique dont nous parlons. Ainsi, on voit Cicéron qui, en particulier, et parmi ses amis, fait à chaque moment une confession d’incrédulité, parler en public avec un zèle extraordinaire contre l’impiété de Verrès. On voit un Clodius, qui avait insolemment profané les mystères de la bonne déesse, et dont l’impiété avait été marquée par vingt arrêts du sénat, faire lui-même une harangue remplie de zèle à ce sénat qui l’avait foudroyé, contre le mépris des pratiques anciennes et de la religion. On voit un Salluste, le plus corrompu de tous les citoyens, mettre à la tête de ses ouvrages une préface digne de la gravité et de l’austérité de Caton. Je n’aurais jamais fait, si je voulais épuiser tous les exemples.
Quoique les magistrats ne donnassent pas dans la religion du peuple, il ne faut pas croire qu’ils n’en eussent point. M. Cudworth a fort bien prouvé que ceux qui étaient éclairés parmi les païens adoraient une divinité suprême, dont les divinités du peuple n’étaient qu’une participation. Les païens, très peu scrupuleux dans le culte, croyaient qu’il était indifférent d’adorer la divinité même, ou les manifestations de la divinité ; d’adorer, par exemple, dans Vénus, la puissance passive de la nature, ou la divinité suprême, en tant qu’elle est susceptible de toute génération ; de rendre un culte au soleil, ou à l’Être suprême, en tant qu’il anime les plantes et rend la terre féconde par sa chaleur. Ainsi, le stoïcien Balbus dit, dans Cicéron, que Dieu participe, par sa nature, à toutes les choses d’ici-bas ; qu’il est Cérès sur la terre, Neptune sur les mers. » Nous en saurions davantage si nous avions le livre qu’Asclépiade composa, intitulé l’Harmonie de toutes les théologies.
Comme le dogme de l’âme du monde était presque universellement reçu, et que l’on regardait chaque partie de l’univers comme un membre vivant dans lequel cette âme était répandue, il semblait qu’il était permis d’adorer indifféremment toutes ces parties, et que le culte devait être arbitraire comme était le dogme.
Voilà d’où était né cet esprit de tolérance et de douceur qui régnait dans le monde païen ; on n’avait garde de se persécuter et de se déchirer les uns les autres : toutes les religions, toutes les théologies, y étaient également bonnes ; les hérésies, les guerres, et les disputes de religion, y étaient inconnues ; pourvu qu’on allât adorer au temple, chaque citoyen était grand pontife dans sa famille.
Les Romains étaient encore plus tolérants que les Grecs, qui ont toujours gâté tout : chacun sait la malheureuse destinée de Socrate.
Il est vrai que la religion égyptienne fut toujours proscrite à Rome : c’est qu’elle était intolérante, qu’elle voulait régner seule et s’établir sur les débris des autres ; de manière que l’esprit de douceur et de paix qui régnait chez les Romains fut la véritable cause de la guerre qu’ils lui firent sans relâche. Le sénat ordonna d’abattre les temples des divinités égyptiennes ; et Valère Maxime rapporte, à ce sujet, qu’Émilius Paulus donna les premiers coups, afin d’encourager par son exemple les ouvriers frappés d’une crainte superstitieuse.
Mais les prêtres de Sérapis et d’Isis avaient encore plus de zèle pour établir ces cérémonies qu’on n’en avait à Rome pour les proscrire. Quoique Auguste, au rapport de Dion, en eût défendu l’exercice dans Rome, Agrippa, qui commandait dans la ville en son absence, fut obligé de le défendre une seconde fois. On peut voir, dans Tacite et dans Suétone, les fréquents arrêts que le sénat fut obligé de rendre pour bannir ce culte de Rome.
Il faut remarquer que les Romains confondirent les Juifs avec les Égyptiens, comme on sait qu’ils confondirent les chrétiens avec les juifs : ces deux religions furent longtemps regardées comme deux branches de la première, et partagèrent avec elle la haine, le mépris et la persécution des Romains. Les mêmes arrêts qui abolirent à Rome les cérémonies égyptiennes mettent toujours les cérémonies juives avec celles-ci, comme il paraît par Tacite, et par Suétone, dans les vies de Tibère et de Claude. Il est encore plus clair que les historiens n’ont jamais distingué le culte des chrétiens d’avec les autres. On n’était pas même revenu de cette erreur, du temps d’Adrien, comme il paraît par une lettre que cet empereur écrivit d’Égypte au consul Servianus : « Tous ceux qui, en Égypte, adorent Sérapis, sont chrétiens, et ceux même qu’on appelle évêques sont attachés au culte de Sérapis. Il n’y a point de juif, de prince de synagogue, de samaritain, de prêtre des chrétiens, de mathématicien, de devin, de baigneur, qui n’adore Sérapis. Le patriarche même des juifs adore indifféremment Sérapis et le Christ. Ces gens n’ont d’autre dieu que Sérapis : c’est le dieu des chrétiens, des juifs et de tous les peuples. » Peut-on avoir des idées plus confuses de ces trois religions, et les confondre plus grossièrement ?
Chez les Égyptiens, les prêtres faisaient un corps à part, qui était entretenu aux dépens du public ; de là naissaient plusieurs inconvénients : toutes les richesses de l’état se trouvaient englouties dans une société de gens qui, recevant toujours et ne rendant jamais, attiraient insensiblement tout à eux. Les prêtres d’Égypte, ainsi gagés pour ne rien faire, languissaient tous dans une oisiveté dont ils ne sortaient qu’avec les vices qu’elle produit : ils étaient brouillons, inquiets, entreprenants ; et ces qualités les rendaient extrêmement dangereux. Enfin, un corps dont les intérêts avaient été violemment séparés de ceux de l’état était un monstre ; et ceux qui l’avaient établi avaient jeté dans la société une semence de discorde et de guerres civiles. Il n’en était pas de même à Rome : on y avait fait de la prêtrise une charge civile ; les dignités d’augure, de grand pontife, étaient des magistratures ; ceux qui en étaient revêtus étaient membres du sénat, et par conséquent n’avaient pas des intérêts différents de ceux de ce corps. Bien loin de se servir de la superstition pour opprimer la république, ils l’employaient utilement à la soutenir. « Dans notre ville, dit Cicéron, les rois et les magistrats qui leur ont succédé ont toujours eu un double caractère, et ont gouverné l’état sous les auspices de la religion. »
Les duumvirs avaient la direction des choses sacrées ; les quindécemvirs avaient soin des cérémonies de la religion, gardaient les livres des sibylles : ce que faisaient auparavant les décemvirs et les duumvirs. Ils consultaient les oracles lorsque le sénat l’avait ordonné, et en faisaient le rapport, y ajoutant leur avis ; ils étaient aussi commis pour exécuter tout ce qui était prescrit dans les livres des sibylles, et pour faire célébrer les jeux séculaires : de manière que toutes les cérémonies religieuses passaient par les mains des magistrats.
Les rois de Rome avaient une espèce de sacerdoce : il y avait de certaines cérémonies qui ne pouvaient être faites que par eux. Lorsque les Tarquins furent chassés, on craignait que le peuple ne s’aperçût de quelque changement dans la religion : cela fit établir un magistrat appelé rex sacrorum, qui, dans les sacrifices, faisait les fonctions des anciens rois, et dont la femme était appelée regina sacrorum. Ce fut le seul vestige de royauté que les Romains conservèrent parmi eux.
Les Romains avaient cet avantage qu’ils avaient pour législateur le plus sage prince dont l’histoire profane ait jamais parlé ; ce grand homme ne chercha pendant tout son règne qu’à faire fleurir la justice et l’équité, et il ne fit pas moins sentir sa modération à ses voisins qu’à ses sujets. Il établit les fécialiens, qui étaient des prêtres sans le ministère desquels on ne pouvait faire ni la paix ni la guerre. Nous avons encore des formulaires de serments faits par ces fécialiens quand on concluait la paix avec quelque peuple. Dans celle que Rome conclut avec Albe, un fécialien dit dans Tite-Live : « Si le peuple romain est le premier à s’en départir, publico consilio, dolove malo, qu’il prie Jupiter de le frapper comme il va frapper le cochon qu’il tenait dans ses mains ; » et aussitôt il l’abattit d’un coup de caillou.
Avant de commencer la guerre on envoyait un de ces fécialiens faire ses plaintes au peuple qui avait porté quelque dommage à la république. Il lui donnait un certain temps pour se consulter et pour chercher les moyens de rétablir la bonne intelligence ; mais si on négligeait de faire l’accommodement, le fécialien s’en retournait, et sortait des terres de ce peuple injuste, après avoir invoqué contre lui les dieux célestes et ceux des enfers : pour lors le sénat ordonnait ce qu’il croyait ,juste et pieux. Ainsi les guerres ne s’entreprenaient jamais à la hâte, et elles ne pouvaient être qu’une suite d’une longue et mûre délibération.
La politique qui régnait dans la religion des Romains se développa encore mieux dans leurs victoires. Si la superstition avait été écoutée, on aurait porté chez les vaincus les dieux des vainqueurs ; on aurait renversé leurs temples ; et, en établissant un nouveau culte, on leur aurait imposé une servitude plus rude que la première. On fit mieux : Rome se soumit elle-même aux divinités étrangères, elle les reçut dans son sein ; et par ce lien, le plus fort qui soit parmi les hommes, elle s’attacha des peuples qui la regardèrent plutôt comme le sanctuaire de la religion que comme la maîtresse du monde.
Mais, pour ne point multiplier les êtres, les Romains, à l’exemple des Grecs, confondirent adroitement les divinités étrangères avec les leurs ; s’ils trouvaient dans leurs conquêtes un dieu qui eût du rapport à quelqu’un de ceux qu’on adorait à Rome, ils l’adoptaient, pour ainsi dire, en lui donnant le nom de la divinité romaine, et lui accordaient, si j’ose me servir
de cette expression, le droit de bourgeoisie dans leur ville. Ainsi, lorsqu’ils trouvaient quelque héros fameux qui eût purgé la terre de quelque monstre, ou soumis quelque peuple barbare, ils lui donnaient aussitôt le nom d’Hercule. « Nous avons percé jusqu’à l’Océan, dit Tacite ; et nous y avons trouvé les colonnes d’Hercule : soit qu’Hercule y ait été, soit que nous ayons attribué à ce héros tous les faits dignes de sa gloire. »
Varron a compté quarante-quatre de ces dompteurs de monstres ; Cicéron n’en a compté que six, vingt-deux Muses, cinq Soleils, quatre Vulcains, cinq Mercures, quatre Apollons, trois Jupiters.
Eusèbe va plus loin : il compte presque autant de Jupiters que de peuples.
Les Romains, qui n’avaient proprement d’autre divinité que le génie de la république, ne faisaient point d’attention au désordre et à la confusion qu’ils jetaient dans la mythologie : la crédulité des peuples, qui est toujours au-dessus du ridicule et de l’extravagant, réparait tout.