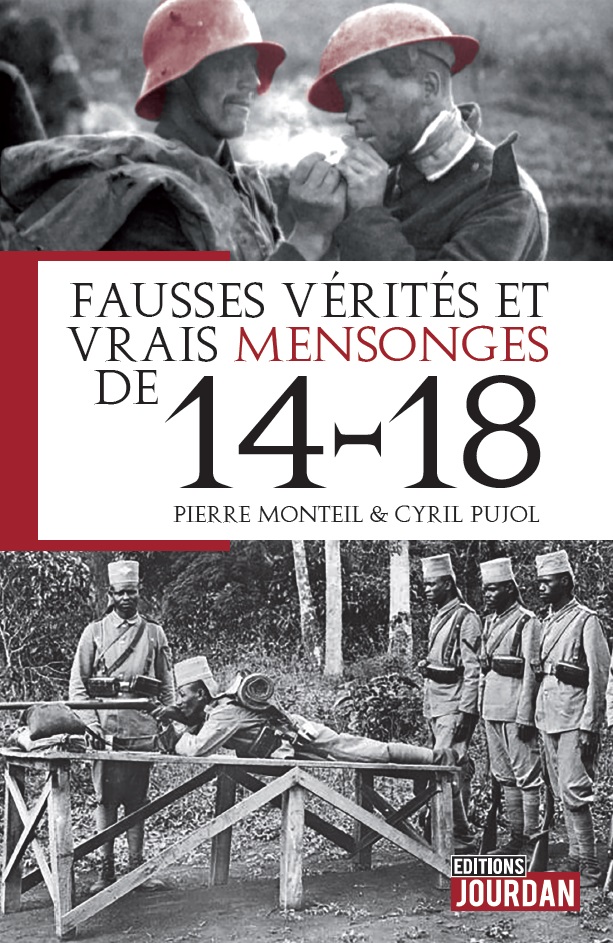I. O mon âme, quand sauras-tu donc enfin être bonne, simple, parfaitement une, toujours prête à te montrer à nu, plus facile à voir que le corps matériel qui t'enveloppe ? Quand pourras-tu goûter pleinement la joie d'aimer et de chérir toutes choses ? Quand seras-tu remplie uniquement de toi-même, dans une indépendance absolue, sans aucun regret, sans aucun désir, sans la moindre nécessité d'un être quelconque vivant ou privé de vie, pour les jouissances que tu recherches ; sans avoir besoin, ni du temps pour prolonger tes plaisirs, ni de l'espace, ni du lieu, ni de la sérénité des doux climats, ni même de la concorde des humains ? Quand seras-tu satisfaite de ta condition présente, contente de tous tes biens présents, persuadée que tu as tout ce que tu dois avoir, que tout est bien en ce qui te touche, que tout te vient des Dieux, que, dans l'avenir qui t'attend, tout sera également bien pour toi de ce qu'ils décideront dans leurs décrets, et de ce qu'ils voudront faire pour la conservation de l'être parfait, bon, juste, beau, qui a tout produit, renferme tout, enserré et comprend toutes les choses, lesquelles ne se dissolvent que pour en former de nouvelles pareilles aux premières ? Quand seras-tu donc telle, ô mon âme, que tu puisses vivre enfin dans la cité des Dieux et des hommes, de manière à ne leur jamais adresser une plainte, et à n'avoir jamais non plus besoin de leur pardon ?
II. Observe attentivement ce que demande ta nature, comme si la nature seule devait te guider ; et une fois que tu connais son voeu, accomplis-le avec constance, jusqu'au point où la nature animale en toi devrait en trop pâtir. En conséquence, observe avec une attention suffisante les exigences de la nature animale. Mais ce soin même doit être subordonné au devoir de n'altérer jamais cette autre nature qui fait de toi un être raisonnable. Or, l'être raisonnable est en même temps un être fait pour la société. En appliquant scrupuleusement ces règles, tu n'as point à te préoccuper d'autre chose.
III. Tout ce qui t'arrive dans la vie, arrive de telle sorte que la nature te l'a rendu supportable, ou que tu es hors d'état de le supporter avec la nature que tu as. Si l'accident est tel que tu sois de force à l'endurer, ne t'en plains pas ; mais subis-le avec les forces que t'a données la nature. Si l'épreuve dépasse tes forces naturelles, ne te plains pas davantage ; car, en te détruisant, l'épreuve s'épuisera elle-même. Toutefois, n'oublie jamais que la nature t'a fait capable de supporter tout ce qu'il dépend de ta volonté seule de rendre supportable, ou intolérable, selon que tu juges que c'est ton intérêt de faire la chose, pu qu'elle est un devoir pour toi.
IV. Quand quelqu'un se trompe, redresse-le avec bienveillance, et montre-lui son erreur. Si tu ne peux le redresser, ne t'en prends qu'à toi seul ; ou mieux encore, ne t'en prends même pas à toi.
V. Quelque chose qui puisse t'arriver en ce monde, cette chose avait été prédisposée pour toi de toute éternité ; et dès l'éternité, l'enchaînement réciproque des causes avait décrété, tout à la fois dans la trame de l'univers, et ta propre existence, et la chose qui t'arrive.
VI. Qu'il n'y ait que des atomes, qu'il y ait une nature, peu m'importe ; un premier principe qu'il faut toujours poser, c'est que je ne suis qu'une partie de ce tout ce que la nature gouverne. Un second principe, suite de celui-là, c'est que je suis dans un certain rapport de parenté avec les parties de ce monde, qui sont de la même espèce que moi. Si je me souviens de ces axiomes, je ne me révolterai jamais, en tant que partie, contre le sort qui m'est assigné dans le tout ; car la partie ne peut pas souffrir de ce qui est utile au tout. En effet, le tout ne peut jamais rien avoir qui ne soit dans son intérêt. Toutes les natures en sont là, et celle de l'univers en particulier. Ajoutez encore à cette première condition le privilège de ne pouvoir être contrainte, par aucune cause extérieure, à produire quoi que ce soit qui puisse lui porter dommage. En me rappelant donc que je suis personnellement une des parties de ce tout, je recevrai avec reconnaissance tout ce qui pourra m'arriver ; et en tant que je suis en quelque sorte de la famille des parties qui sont de même espèce que moi, je me garde de faire rien de ce qui pourrait blesser la communauté. Bien plus, je penserai sans cesse à ces êtres mes semblables, et je dirigerai tous mes efforts vers le bien commun, et me défendrai de tout ce qui pourrait y être contraire. Ces divers devoirs étant bien remplis, le cours de la vie doit être nécessairement heureux, si tu admets que le citoyen coule réellement une vie heureuse quand il la passe à ne faire que des actes utiles à ses concitoyens, et qu'il accepte avec joie la part que lui accorde l'État.
VII. Les parties de l'univers qui, d'après la loi de la nature, sont comprises dans le monde où nous sommes, doivent périr de toute nécessité. D'ailleurs, périr ne signifie pas autre chose que changer. Mais si, pour ces parties, changer est un mal naturel et un mal nécessaire, c'est qu'alors le tout serait mal constitué, les parties étant fort disparates, et, en ce qui regarde la destruction, étant traitées différemment les unes des autres. Est-ce donc que la nature elle-même a résolu de maltraiter ses parties diverses, et, en les assujettissant au mal, les y a-t-elle fait nécessairement tomber ? Ou bien tous ces phénomènes ont-ils lieu à son insu ? Les deux suppositions sont également inadmissibles. Que si, laissant de côté l'intelligence de la nature, on prétendait expliquer les choses en disant simplement qu'elles sont ce qu'elles sont, l'explication serait encore ridicule, puisque, d'une part, on affirmerait que les choses sont faites pour changer, et que, d'autre part, on s'étonnerait et l'on se plaindrait même d'un de ces changements, comme s'il était contre nature, quoique après tout il ne s'agisse que de la dissolution des êtres dans leurs propres éléments. De deux choses l'une en effet : ou c'est la simple dispersion des éléments dont l'être avait été formé ; ou c'est une transformation, laquelle, par exemple, fait changer en terre la partie solide de notre corps, et le souffle vital en air, de telle façon que ces principes rentrent dans la substance de l'univers, destiné lui-même à être consumé par le feu, après une période déterminée, ou à se renouveler par des changements éternels. Même avec cette hypothèse, ne va pas t'imaginer que, dans ton être, cette partie solide et cette partie de souffle vital soient exactement encore aujourd'hui ce qu'elles étaient à l'époque de ta naissance. Ton être actuel, dans sa totalité, a puisé ce qu'il est aux aliments que tu as pris et à l'air que tu as respiré, depuis deux ou trois jours peut-être. Ce qui change, c'est ce que ton corps avait récemment absorbé, et non pas ce qu'il avait reçu jadis du sein maternel. Mais prends garde de t'égarer en tenant trop de compte d'une organisation particulière et spéciale, qui n'a rien à faire, selon moi, à ce que je dis ici.
VIII. Quand tu te seras conquis le renom d'homme honnête, modeste, sincère, prudent, résigné, magnanime, veille bien à ne jamais t'attirer des appellations contraires ; que si tu perds tes titres à ces noms honorables, hâte-toi de les reconquérir, au plus vite, de ton mieux. Souviens-toi qu'être Prudent, cela veut dire qu'on s'applique à examiner chaque objet attentivement et sans négligence ; qu'être Résigné, c'est accepter de sa pleine volonté le destin que nous répartit la commune nature ; que Magnanime désigne l'empire de la partie pensante de notre être sur les émotions agréables ou pénibles de la chair, sur la vaine gloire, sur la mort, et sur toutes les choses de cet ordre. Si donc tu continues à mériter réellement ces noms, sans t'inquiéter d'ailleurs de les recevoir de la bouche d'autrui, tu deviendras tout différent de ce que tu es, et tu entreras dans une tout autre vie. Car demeurer encore ce que tu as été jusqu'aujourd'hui, être toujours lacéré et souillé par cette conduite que tu as antérieurement menée, c'est avoir par trop perdu tout sentiment, c'est par trop aimer l'existence; c'est par trop ressembler à ces bestiaires à demi dévorés, qui, criblés de blessures et couverts de boue , n'en demandent pas moins avec instance qu'on les conserve pour le jour suivant, afin qu'ils puissent encore , dans l'état où ils sont, aller s'exposer aux griffes et aux dents qui les ont déjà déchirés. Affermis-toi donc dans la possession de ces quelques noms honorables ; et, si tu peux rester sur ce ferme terrain, restes-y, comme si tu avais le bonheur d'avoir été transplanté dans les îles des Bienheureux. Si tu vois que tu en sors, et que tu n'es plus de force à y demeurer, aie alors le courage de te retirer dans quelque lieu écarté, où tu pourras redevenir ton maître et recouvrer tes forces. Sinon, sors définitivement de ce monde, non pas dans un accès de fureur, mais au contraire, avec simplicité, avec ta liberté entière, modestement, et n'ayant fait de bien qu'une seule chose dans ta vie, à savoir d'en être sorti de cette façon. Pour te rappeler tout ce que valent ces noms qu'il faut mériter, ce sera un grand appui pour toi de te rappeler aussi qu'il y a des Dieux, que ce qu'ils veulent, ce n'est pas d'être flattés, c'est d'être imités par les êtres auxquels ils ont accordé la raison ; et que si le figuier doit remplir le rôle de figuier, le chien le rôle de chien, l'abeille le rôle d'abeille, l'homme doit remplir également ses fonctions d'homme.
IX. Un histrion, des travaux de guerre, un vain effroi, la paresse, la servilité d'esprit, effaceront chaque jour de ton âme les saintes maximes que nous découvre l'étude de la nature, et que tu négliges. Tes réflexions et tes actes doivent toujours être conduits de telle sorte que tu accomplisses à la fois ce que les circonstances exigent, et qu'en même temps tu pratiques ce que la théorie nous enseigne ; et sache, avec tout ce que nous peut apprendre la science des choses, conserver une satisfaction intime qui ne se montre pas, mais qui ne se cache pas non plus. Quand sentiras-tu le plaisir d'être simple, le plaisir d'être grave, le plaisir de connaître chaque chose, en connaissant ce que cette chose est dans son essence, la place qu'elle occupe dans le monde, la durée que la nature lui accorde, les éléments dont elle est composée, les êtres à qui elle peut appartenir, et ceux qui peuvent, ou nous la procurer, ou nous la ravir ?
X. Une araignée est toute fière d'avoir pris une mouche ; tel chasseur est tout fier d'avoir pris un lièvre ; tel pêcheur d'avoir pris une sardine dans son filet ; tel autre d'avoir pris des sangliers ; tel autre encore, des ours ; tel autre, enfin, des Sarmates. A ne considérer que les principes, ne sont-ils pas tous également des brigands et des voleurs ?
XI. Il faut se rendre bien compte, par une étude méthodique, de la manière dont les choses se changent les unes dans les autres ; applique-toi sans cesse à cette question, et fais-en spécialement le constant exercice de ta pensée. Rien n'est plus propre à élever l'âme ; elle se dépouille du corps ; et quand l'homme songe qu'il va falloir dans un instant quitter tout cela, en sortant de la société de ses semblables, il se consacre tout entier et il se dévoue à la justice, dans les actes qui dépendent de lui ; il se soumet, pour tout ce peut lui arriver d'ailleurs, à la nature universelle des choses. Quant à ce que les autres hommes pourront dire ou penser de lui, bien plus, quant à ce qu'ils pourront faire contre lui, cette idée ne lui entre même pas dans l'esprit, satisfait de ces deux seuls points, à savoir, de pratiquer la justice dans tout ce qu'il fait actuellement, et de toujours se trouver heureux du sort qui lui est actuellement accordé. C'est ainsi qu'on se délivre de toutes les préoccupations, de tous les soucis, et qu'on ne veut rien au monde que marcher sur la droite ligne, en observant la loi, qui est d'obéir à Dieu, dont les sentiers sont toujours droits.
XII. Quel besoin as-tu de tant de réflexion dès que tu peux voir ce que tu dois faire ? Si tu l'aperçois clairement, n'hésite pas à marcher à cette lumière, d'un coeur tranquille, et sans te laisser détourner de ta route. Si tu ne le vois pas assez nettement, tu n'as qu'à t'arrêter et à recourir aux conseils les plus éclairés. S'il se présente encore d'autres difficultés qui s'opposent à tes desseins, tu peux toujours t'avancer, en scrutant avec réflexion les motifs que tu as actuellement d'agir, et en t'en tenant à ce qui te semble juste. C'est le point essentiel ; il faut t'en assurer, bien que du reste tu puisses échouer dans ce que tu poursuis. Suivre en toutes choses les conseils de la raison, c'est tout à la fois se garantir la paix et se faciliter tous ses mouvements ; c'est à la fois brillant et solide.
XIII. Au moment où tu t'éveilles, tu peux te demander à toi-même : «S'il t'importera personnellement qu'un autre que toi se conduise avec justice et probité». Non sans doute, cela ne t'importe en rien. Est-ce que tu ignores comment ces gens, si impertinents dans les louanges ou dans les critiques qu'ils font d'autrui, se conduisent eux-mêmes au lit, comment ils se conduisent à table ? Ignores-tu leurs manières de faire, les objets de leurs craintes, les objets de leurs convoitises, leurs rapines, leurs vols, qu'ils accomplissent, non pas en se servant de leurs mains et de leurs pieds, mais en y appliquant la partie la plus précieuse de leur être, celle qui peut avoir, quand elle le veut, la loyauté, la pudeur, la vérité, l'obéissance à la loi, et qui peut devenir le bon génie de l'homme ?
XIV. L'homme éclairé et respectueux dit à la nature, qui nous donne tout et qui peut tout nous reprendre : «Donne-moi ce que tu veux ; reprends-moi ce que tu veux». Mais s'il tient ce langage, ce n'est pas pour braver la nature audacieusement ; c'est uniquement parce qu'il est docile et reconnaissant envers elle.
XV. Ce qui te reste à vivre est bien peu de chose. Vis donc comme si tu étais au sommet d'un mont ; car il n'importe point qu'on soit ici ou qu'on soit là, puisque partout on est dans le monde comme dans une cité. Que les humains puissent enfin voir et contempler à leur aise un homme véritable, qui vit selon les lois de la nature. Que s'ils ne peuvent pas en supporter la vue, qu'ils l'égorgent ; car, pour lui, la mort serait préférable à la vie que mène le vulgaire.
XVI. Il n'est plus temps de discuter sur les conditions que l'homme de bien doit remplir ; il s'agit uniquement d'être homme de bien.
XVII. Essaie sans cesse de te représenter l'image de la totale durée, de la totale substance ; et dis-toi bien que tous les êtres particuliers valent, comparés à la substance, un grain de millet, et, comparés au temps éternel, un tour de vrille.
XVIII. En examinant un objet quelconque, figure-le-toi comme s'il était déjà dissous, et soumis au changement qui doit le transformer, comme s'il était déjà exposé à la corruption qui l'attend, et à la dispersion de toutes ses parties, c'est-à-dire en cet état où, selon les lois de la nature, tout être doit mourir, à ce qu'il semble.
XIX. Qu'est-ce donc que sont les hommes, qui mangent, qui dorment, qui s'accouplent, qui rendent leurs excréments, et qui sont soumis à tant d'autres besoins ! Et cependant, quel orgueil n'ont-ils pas d'être hommes ! Quelle morgue ! Que de dureté pour les autres, qu'ils traitent du haut d'une écrasante supériorité ! Et l'instant d'auparavant, de qui n'étaient-ils pas les esclaves ? Et pourquoi s'abaissaient-ils ainsi ? Dans un instant, ne reviendront-ils pas encore aux mêmes bassesses ?
XX. Tout ce que la nature universelle comporte pour un être est utile à cet être, et, de plus, lui est utile au moment où la nature le lui donne.
XXI. «La terre aime la pluie, ainsi que l'air immense». Il en est de même pour le monde, qui se plaît à faire tout ce qui doit être. Je dis donc au monde : «J'aime avec toi tout ce que tu aimes». Ne dit-on pas aussi, en parlant même d'une chose, qu'elle aime à être de telle ou telle façon ?
XXII. Ou bien tu continues à vivre où tu es, et c'est pour toi chose d'habitude ; ou bien tu t'en vas, et c'est parce que tu l'as voulu ; ou enfin tu meurs, et alors tu as fini ton service. Hors de ces trois hypothèses, il n'y en a pas d'autre. Ainsi, aie bon courage.
XXIII. Qu'il soit toujours parfaitement évident pour toi que la ville, que tu habites, est précisément ce qu'est la campagne. Sache bien aussi que les choses y sont tout à fait identiques à ce qu'elles sont au sommet des montagnes, sur le rivage des mers, en un mot, partout où tu voudras. Tu pourras voir combien est vrai ce que dit Platon dans ce passage : «Les rois ne sont ni moins grossiers ni moins ignorants que des pâtres, à cause du peu de loisir qu'ils ont de s'instruire, renfermés entre des murailles, comme dans un parc sur une montagne...»
XXIV. Dans quel état est en moi la faculté qui doit me conduire ? Qu'est-ce que j'en fais en ce moment même ? A quel usage est-ce que je l'applique maintenant ? Est-elle dénuée de raison ? Ne s'est-elle pas isolée et arrachée de la communauté, à laquelle elle appartient ? Ne s'est-elle pas tellement absorbée et confondue dans cette misérable chair, qu'elle en subisse et en partage toutes les fluctuations ?
XXV. L'esclave qui fuit son maître est un déserteur et un fugitif ; or notre maître, c'est la loi ; donc transgresser la loi, c'est fuir et déserter. Par la même raison, on a tort et l'on transgresse la loi quand on s'afflige, quand on s'emporte, quand on s'effraie pour une de ces choses passées, présentes ou futures, lesquelles sont réglées par Celui qui régit l'univers, par Celui qui est la loi même, répartissant à chacun ce qui lui revient. Ainsi, la crainte, la douleur, la colère, ce sont là autant de désertions.
XXVI. La semence une fois versée dans l'organe qui la doit recevoir, le père disparaît. Pour ce qui se développe ensuite, c'est une autre cause qui, recevant ce germe, élabore et parachève l'enfant. Quel début ! Quel progrès ! Puis l'enfant absorbe de la nourriture, qui passe par sa bouche. Et pour ce qui va suivre encore, c'est également une autre cause qui, recevant ces premiers matériaux, produit la sensibilité, les passions, en un mot, la vie, avec les forces et toutes les facultés qui la composent. En quel nombre ! Avec quelle énergie ! Contemplons ce qui se passe dans ces profondes ténèbres, voyons la force qui produit ces merveilles, ainsi que nous voyons la force qui précipite les corps en bas, ou qui les fait monter en haut. Certes, ce n'est pas l'affaire de nos yeux ; mais le fait n'en est pas moins d'une évidence éclatante.
XXVII. Répète-toi sans cesse que la manière dont les choses se passent actuellement est aussi la manière dont elles se passaient jadis, dont elles se passeront plus tard. Remets-toi sous les yeux tous ces drames, tous ces théâtres, toujours si uniformes, que tu as pu connaître, soit par ton expérience personnelle, soit par les récits d'une histoire plus ancienne ; par exemple, tout ce que l'on a fait à la cour d'Adrien, a celle d'Antonin, et tout ce qu'on faisait dans les cours de Philippe, d'Alexandre, de Crésus. Elles étaient absolument comme celle que tu as ; il n'y avait que les acteurs de changés.
XXVIII. Représente-toi bien qu'un homme qui s'afflige de quoi que ce soit, ou qui se révolte contre les choses, ressemble à un de ces pourceaux traînés au sacrifice, qui regimbent en grognant. C'est l'image de celui qui, couché sur son lit solitaire, se plaint eu secret du destin qui nous enchaîne. Dis-toi bien aussi que le privilège de l'être doué de raison, c'est d'obéir de son plein gré aux événements, tandis que, pour tous les autres êtres, y obéir purement et simplement est une absolue nécessité.
XXIX. A chacun des actes que tu accomplis, demande-toi si la mort te semble plus particulièrement affreuse, parce qu'elle doit te priver de l'objet qui t'occupe.
XXX. Lorsque tu t'offusques de la faute de quelqu'un, fais un retour sur toi-même, et pense un peu aux fautes analogues que, toi aussi, tu commets ; par exemple, quand tu fais trop de cas de l'argent, du plaisir, de la vaine gloire, et de tant d'autres objets, qui ne valent pas mieux. Si tu t'attaches h cette réflexion, tu auras bien vite oublié ton irritation, et tu te diras : «Il y était forcé ; que pouvait-il faire ?» Ou bien même, si tu le peux, fais disparaître la contrainte que le malheureux subit.
XXXI. Quand tu vois Satyron, pense à un philosophe socratique, ou à Eutychès, ou à Hymen ; quand tu vois Euphrate, pense à Eutychion, à Silvanus ; quand c'est Alciphron, pense à Tropaeophore ; en voyant Xénophon, pense à Criton ou à Sévérus ; enfin, en regardant à toi-même, reporte ta pensée sur un des Césars. En un mot, dans chaque cas qui se présente, fais une comparaison analogue. Puis adresse-toi cette question : «Et tous ceux-là, où sont-ils ? Nulle part, en ce monde ; ou bien, ils sont n'importe où». En te mettant sans cesse à ce point de vue, tu comprendras que les choses humaines ne sont que fumée et que néant. Tu en seras surtout convaincu, si tu te rappelles en même temps que l'être qui a une fois changé et disparu ne redeviendra jamais ce qu'il a été, dans toute la durée du temps infini. Et toi, dans combien de temps vas-tu changer aussi ? Est-ce qu'il ne te suffit pas d'avoir fourni comme il convient cette courte carrière ? Quelle réalité, quelle chimère peux-tu craindre et fuir encore ? Qu'est-ce, en effet, que tout cela, si ce n'est une suite d'exercices pour la raison, appréciant nettement, et par l'étude exacte de la nature, ce que valent les choses de la vie ? Arrives-en donc avec persévérance à t'assimiler ainsi ces vérités, de même qu'un estomac robuste s'assimile tous les aliments, de même qu'un feu qui brille convertit en flamme et en lumière éclatante tout ce qu'on y jette.
XXXII. Que personne ne puisse jamais se permettre de dire de toi avec vérité que tu n'es pas simple ou que tu n'es pas bon ; qu'à, ton égard un tel soupçon soit toujours une calomnie. Tout cela ne dépend que de toi. Qui pourrait, en effet, t'empêcher d'être bon et simple ? Tu n'as qu'à te résoudre à ne pas continuer de vivre, si tu n'avais pas ces qualités ; car la raison ne te retient pas dans la vie, si tu ne les possèdes point.
XXXIII. Sur une question donnée, qu'y a-t-il de mieux à faire ou à dire, dans la mesure du possible ? Quelle que soit cette question, il t'est toujours permis de faire ou de dire ce qu'il y a de mieux. Et ne va pas alléguer pour excuse que tu en es empêché. Tu ne cesseras de te plaindre que quand, aussi ardent que les amis du plaisir le sont dans leurs jouissances, tu sauras accomplir tout ce que comporte la constitution de l'homme, dans la question qui se présente et qu'il faut résoudre ; car tout être doit regarder comme une jouissance véritable de faire ce que permet sa nature propre. Or, toujours et partout, il est possible de s'y conformer. Ainsi, une boule ne peut pas toujours et partout obéir au mouvement qui lui est propre ; le mouvement propre n'est pas non plus toujours possible pour l'eau, le feu, et tant d'autres choses, qui n'obéissent qu'à la nature, ou pour une âme qui n'est pas douée de raison, attendu qu'il peut y avoir une foule d'obstacles qui les empêchent et les arrêtent. Mais l'intelligence et la raison peuvent toujours se frayer leur route à travers tous les obstacles, selon leur nature et dans la plénitude de leur volonté. Si tu te mets bien devant les yeux cette facilité merveilleuse que possède la raison de passer au travers de tout, comme le feu monte en haut, comme la pierre descend en bas, comme l'objet rond roule sur un plan incliné, ne recherche dès lors rien de plus ; car tous ces obstacles, qui ne regardent que le corps et notre cadavre, et qui sont en dehors de notre volonté et du domaine de la raison même, n'ont pas le don de nous blesser ; ils ne nous font absolument aucun mal, puisque, dans ce cas, l'être qui en serait vraiment atteint, devrait périr à l'instant même. Il est bien vrai que, dans les autres combinaisons de choses, quand il survient un mal quelconque, ce mal empire la condition de l'être qui en est atteint ; mais ici, au contraire, il faut bien se dire que l'homme n'en devient que meilleur et d'autant plus louable, quand il fait bon usage des épreuves qu'il subit. Souviens-toi donc toujours que le véritable et naturel citoyen ne souffre jamais de ce qui ne fait pas souffrir la cité, et que la cité même n'éprouve aucun dommage quand la loi n'en éprouve point. Or, dans ces prétendus revers, il n'y a rien qui blesse la loi ; et, dès lors, ce qui ne blesse point la loi ne blesse point non plus, ni la cité, ni le citoyen.
XXXIV. Une fois qu'on a mordu aux vrais principes, il suffit du plus simple mot, d'une sentence connue de tout le monde, pour se souvenir qu'on ne doit avoir ni tristesse, ni crainte :
Le vent les jette à terre et pourtant la nature...
Ainsi sont les humains...
Ce sont également des feuilles que tes enfants ; ce sont aussi des feuilles légères que les clameurs enthousiastes qui chantaient tes louanges, ou, en sens contraire, ces malédictions, ces critiques, ces railleries dont on t'accablait. Ce sont des feuilles encore, et non moins légères celles-là, que ces voix qui propageront successivement ton souvenir dans la postérité. Oui, ce sont là autant de feuilles.
...Et pourtant la nature,
Chaque année, au printemps, ramène la verdure.
Puis, le vent les a dispersées encore une fois, et la forêt en produit d'autres à leur place. Ainsi donc, cette durée éphémère est la condition commune de toutes choses. Et toi, tu prends toutes choses, soit que tu les fuies, soit que tu les recherches, comme si elles devaient être éternelles ! Encore un peu, et tes yeux se fermeront aussi ; et celui-là même qui t'aura porté en terre sera, à son tour, pleuré par un autre, qui l'y portera.
XXXV. Lorsque l'oeil est sain, il regarde tout ce qui peut être regardé, et il ne dit pas : «C'est du vert que je veux voir». Car le vert n'est un besoin que pour l'oeil qui est malade. De même, l'ouïe quand elle saine, l'odorat quand il est sain, doivent être tout prêts à entendre les sons et à sentir les odeurs. L'estomac qui est sain doit être aussi bien disposé pour tous les aliments qu'il reçoit, de même encore qu'une meule de moulin doit être prête à moudre tous les grains qu'on y apporte. Ainsi donc, l'âme, quand elle est vraiment saine, doit être préparée à tous les événements. Mais l'âme qui dit : «Que mes enfants vivent ; ou bien : Que tout le monde me comble de louanges dans tout ce que je fais», cette âme-là n'est qu'un oeil qui cherche à voir du vert, ou des dents qui ne veulent que des aliments mous et faciles à broyer.
XXXVI. Il n'est personne qui soit assez heureux pour n'avoir point auprès de soi, quand il meurt, des gens prêts à prendre assez tranquillement le mal qui lui arrive. «Sans doute, c'était un honnête homme, diront-ils ; c'était un sage». Mais n'y aura-t-il pas aussi quelqu'un pour se dire, en fin de compte, et à part lui : «Nous voilà donc délivrés de ce pédagogue ; respirons enfin. Certes, il n'était méchant pour personne de nous ; mais je sentais bien qu'au fond du coeur il nous désapprouvait» ? Voilà ce qu'on dit d'un honnête homme. Mais, nous autres, combien de motifs ne fournissons-nous pas à ceux qui, en grand nombre, voudraient être débarrassés de nous ? C'est là ce qu'on doit penser à son lit de mort, et la réflexion suivante te fera quitter la vie plus aisément : «Je sors de cette vie, où même mes associés de route, pour qui j'ai tant lutté, fait tant de voeux, pris tant de peine, désirent, malgré tout cela, que je m'en aille, espérant que ma mort leur procurera peut-être une facilité quelconque de plus». Quel motif pourrait donc nous faire souhaiter de demeurer plus longtemps ici-bas ? Toutefois ne va pas, en partant, montrer moins de bienveillance pour eux ; conserve à leur égard ton caractère habituel ; reste affectueux, indulgent, doux, et ne semble pas avoir l'air d'être éconduit. Mais de même que, quand on a une mort facile, l'âme s'exhale aisément du corps, de même il faut que tu prennes congé de tes semblables avec une inaltérable sérénité. Car c'est la nature qui avait formé ton lien avec eux et qui le rompra. Mais voici qu'elle le rompt. Eh bien, je me sépare d'amis qui me sont chers, sans qu'on ait besoin de m'arracher d'au milieu d'eux, et sans qu'il faille me faire violence ; car cette séparation même est une chose qui n'a rien que de conforme à la nature.
XXXVII. Autant que possible, quand tu vois agir quelqu'un, prends l'habitude de te demander à toi-même : «Quel motif cet homme peut-il bien avoir pour faire ce qu'il fait ?» Commence ainsi par toi-même, et soumets-toi le premier à ton examen.
XXXVIII. Dis-toi bien que le principe qui met tes fibres en mouvement est tout intérieur et caché en toi. Ce principe est ce qui te fait parler ; c'est la vie, et, s'il faut le dire d'un mot, c'est l'homme. Ne le confonds jamais dans ta pensée avec le vase qui le renferme, avec les organes dont il est entouré et revêtu. Ils sont à ton usage comme tous les autres instruments, une cognée, par exemple ; et la seule différence, c'est que c'est la nature qui nous les donne. Mais ces parties de ton corps, sans la cause qui en provoque ou en arrête le mouvement, seraient aussi inutiles que la navette sans l'ouvrière qui tisse, que le roseau sans la main qui écrit, ou que le fouet sans le cocher qui le tient.